(53) R. Gandilhon, Inventaire des Archives de la Société d'Agriculture, Corn. Sc. Et Arts de la Marne, 1954.(54) Arch. d6p. Marne, Matrices cadastrales de Saint-Martin-sur-le-Pré, Châlons-sur-Marne et l'Épine.(55) Arch. dép. Marne 139 M 3.(56) Annuaire du département de la Marne 1825, p. 187-191.(57) G. Duwau, Les Instituteurs, 19 61, page 12 .(58) J, Berland, La création et les débuts de I'école Normale primaire de la Marne, 1934.(59) Arch. dép. Marne, Minutes du notaire Arnould IChâlonsl Succession de I'abbé Brisson.(60) Ibid.(61) Arch. dhp. Marne 2 14325.(62) Le banquier Le Conte, qui avait fondé son affaire en 1814, fut le père de I'abbé Louis Le Conte (1842-1907), qui fut au temps de Mgr Meignan le créateur et l'animateur de nombreuses oeuvres diocésaines, qu'il logea dans une propriété de famille, aujourd'hui la « Maison des Œuvres », 27 rue Pasteur. La mère de I'abbé était une fille du notaire Arnould. (Voir Abbé Thibault, L'abbé Le Conte, Châlons, 1910).La Cathédrale de Châlons (côté Sud) où I'abbé Brisson devint chanoine titulaireLan franco 1158% 16471 S. Paul
(Tableau ayant appartenu B l'ab68 Brisson, qui le légua à Jules Garinet ; il est aujourd'hui au musé Garinet)
CI. Musées de Châlons
LA VIE DE PIERRE BRISSON (1761-1838)
PEDAGOGUE, AGRONOME, CURE DE L’EPINE DE 1822 à 1834
par Georges CLAUSE, Université de Reims
Biens fonciers et compétence agronomique
II reste de nombreux détails à élucider dans la biographie de I'abbé Brisson. Le fils du maître d'école de Soudron, qui n'était pas lui-même dépourvu de biens comme le montant de ses impôts le donne à penser, avait à la fin de sa vie une large aisance dont nous ne connaissons pas l'origine. Peut-être des dépouillements méthodiques de minutes notariales pourraient-ils combler cette lacune ?
La possession de biens fonciers avait-elle amené Pierre Brisson à s'intéresser aux problèmes agricoles ? II est frappant de constater que le principal du Collège de Châlons qui avait été admis en 1806 à la Société Académique comme membre titulaire, après lui avoir adressé un discours sur l'utilité des Sciences, n'y fera plus désormais que des rapports sur des expériences agricoles très concrètes : essai d'amélioration des sols à la Chapelle-sous -Orbais (15 mai 1806), culture du sainfoin et de la pimprenelle à Montepreux et à Chapelaine (ler août 1808), plantations à Vésigneul-sur-Coole -chez un cousin Desallangre (2 juillet 1810), étude de la charrue-semoir de Goret de Dormans (1er juillet 1811), mémoire sur le défrichement des prairies au long de la Marne (16 août 1817) ( 53 ).
Si l'agriculture tenait ainsi à coeur à Pierre Brisson, c'est qu'il possédait vers 1825, date de I'établissement des cadastres des communes concernées, 15 hectares de propriété à Saint-Martin-sur-le-Pré, 12 hectares à Châlons, 5 hectares à I'Epine ( 54 ). A Saint-Martin ses biens étaient constitués d'une maison avec jardin et chènevière, d'oseraies ( 3 ha ), de bois ( 1 ha ), d'une pièce d'eau (presque 1ha), et de 9 hectares labourables. L'ensemble était jugé d'un revenu imposable de 417,35 F ( 54 ). Sur les 430 cotes de la commune, Pierre Brisson arrive au 8e rang pour les surfaces possédées et au 7e pour le revenu imposable. A Châlons, il possédait surtout des terres cultivables – 8 hectares d'une seule pièce -au lieudit I'lslet. Le revenu imposable était estimé à 368.33 F . Les terres de I'Epine n'étaient censées rapporter que 26,26 F .
II eût été normal que I'abbé Brisson louât ses terres, mais lors de sa succession en 1838, alors que plusieurs terres avaient été cédées quelque temps auparavant, un recouvrement tardif du prix de récoltes vendues sur pied le 16 juillet 1837 est mentionné. L'abbé Brisson a-t-il été jusqu'à diriger personnellement l'exploitation de la totalité ou d'une partie de ses biens ? En tout cas comme le prouve son mémoire de 1817, il suivait de près les problèmes propres à la Champagne châlonnaise.
Et lorsqu' Alexandre Godard, payeur du département de la Marne, qui avait hérité de son oncle Delfraisse le Château de Juvigny et la ferme de Virly, constitua en 1821 le Comice agricole de l'arrondissement de Châlons - un des premiers de France à cette date - qui sera étendu à tout le département en 1825, il fera rapidement appel à I'abbé Brisson pour figurer parmi ses membres ( 55 ). Le clergé apparaissait nécessaire dans une pareille institution comme garantie morale, mais aussi à cause de son influence sur les campagnes. L'évêque Mgr de Prilly fut coopté dès son arrivée à Châlons. Mais le cas de I'abbé Brisson est différent : il s'agit d'un véritable praticien, curé de surcroît d'une paroisse de cette Champagne Châlonnaise où l'on multipliait les expériences d'amendements. On doit d'ailleurs remarquer combien le clergé de cette époque est présent dans I'agriculture concrète.
L'abbé Virguin curé de Saint-Jean de Châlons est un des rapporteurs fréquemment entendus par l'Académie de Châlons au temps du Premier Empire : il est parfaitement au courant des premiers essais de batteuses mécaniques ou de l'intérêt des cendres sulfureuses de la Montagne de Reims utilisées comme engrais. En 1825 le chanoine Gayat de l'Enclos préside la commission sur les pépinières d'arbres indigènes ou exotiques qu'on s'efforce d'acclimater à Châlons ; le chanoine Thomas, Grand Ecolâtre du Chapitre, envoie un rapport sur la reproduction des résineux par marcottage. Mais surtout en cette année 1825 le Comice va récompenser le curé de Soudron, I'abbé Gallois, très lié avec Pierre Brisson. Celui-là vient de planter 50 hectares de résineux sur ses propriétés. Dans le rapport adressé au Comice, Gallois, parlant de lui à la troisième personne, avait expliqué qu'il était resté dans son rôle de curé en montrant l'exemple : « Avec une fortune bornée, il avait fait de grands sacrifices pour donner à ses paroissiens un exemple qu'ils s'empressent de suivre de toutes parts ...» et cela « malgré la fonction qui occupe presque tous ses moments ».
L'inspection des écoles
Cependant le rôle de Brisson au Comice fut effacé. II n'était plus jeune et son temps était par ailleurs fort pris. En effet l'ordonnance royale du 8 avril 1824 plaçait les écoles primaires des villes et des campagnes dans la dépendance de l'évêque et sous la surveillance du clergé. Les évêques, ressuscitant un terme médiéval, ont alors désigné un Grand Ecolâtre dans leur chapitre cathédral. A Châlons ce rôle fut dévolu au chanoine Jean-Baptiste Thomas. Celui-ci était né à Metz en 1767 et il semble bien qu'il n'ait été introduit dans le diocèse de Châlons qu'en 1824, amené par le nouvel évêque. Peut- être avait-il des compétences pédagogiques particulières ? II s'était installé au n° 11 de la rue Saint Dominique. Les 26 août et 16 octobre 1824 il avait adressé aux doyens, curés et desservants du diocèse des instructions très précises et un questionnaire d'enquête minutieux ( 56 ).
Celui-ci concernait bien plus la moralité, la pratique religieuse des instituteurs et leur soumission à l'égard de leur curé, que leurs qualités d'enseignants. Les questionnaires remplis devaient être regroupés par un «Comité surveillant» constitué dans chaque canton et présidé par le curé-doyen assisté de deux desservants choisis par lui. Ce « Comité surveillant » devait se réunir chaque mois dans le presbytère du doyen. II était la cheville ouvrière de l'enseignement primaire, s'occupant du personnel et du matériel des écoles. Les demandes d'autorisation d'enseigner devaient parvenir à I'Ecolâtre, annotées par lui. II pouvait faire destituer les maîtres par ses rapports. II était chargé de l'inspection des écoles primaires. Chaque membre du Comité était plus spécialement affecté à celles qui avoisinaient sa résidence. Celui-ci devait pour inspecter le maître d'école se faire accompagner du curé de la paroisse. Les rapports d'inspection étaient transmis chaque année à I'Ecolâtre au début de septembre. Cet enseignement replacé totalement sous la coupe de I'Eglise, -plus même qu'au XVllle siècle car il s'y ajoutait maintenant une espèce de bureaucratie a fait crier à l' « obscurantisme » les Libéraux adversaires du gouvernement de la Restauration. Disons tout de même à la décharge de celui-ci que I'enseignement élémentaire dans les campagnes ne s'était pas amélioré pendant la Révolution et l'Empire. Sa qualité avait même dû baisser par rapport au XVllle siècle (57). Napoléon s'en était désintéressé. II était par contre au premier plan des soucis des gouvernants de la Restauration. Mais les Ultras au pouvoir depuis 1824 ont voulu « remoraliser » la société en même temps que l'instruire. Pour cela ils ont fait appel à l'Église que I'Etat révolutionnaire, et napoléonien avait cherché à évincer de I'enseignement avec plus ou moins de réussite. Mais ils liaient aussi étroitement la Religion et la Politique pour le malheur de l'État et de I'Eglise !
Des progrès vont tout de même être réalisés dans I'enseignement élémentaire. Des concours cantonaux organisés entre les maîtres d'école provoquent entre eux une émulation. Et la formation des maîtres va passer à l'ordre du jour. Le décret qui prévoyait des « Cours normaux » datait d'ailleurs de 1808, mais il n'avait guère reçu d'application. En 1831 la Société Académique de la Marne proposait un projet détaillé pour la création d'une École normale, qui retiendra l'attention du ministre (58). Finalement on fit appel à Châlons à un maître de pension estimé, Jules Leherle, dont l'établissement fut transformé en École Normale le 17 mai 1833, un mois avant la loi Guizot qui fut votée le 28 juin. Au développement de cet établissement, I'abbé Brisson, qui prêtera à Jules Leherle 20000 F en 1837, pourrait bien avoir contribué indirectement (59).
Mais en attendant la loi fondamentale de 1833, I'abbé Brisson visitait fréquemment les écoles primaires dans toute l'étendue de son doyenné. II apportait un soin particulier à la situation des « enfants des Hôpitaux », c'est-à-dire aux enfants abandonnés et confiés aux Hospices qui les plaçaient en nourrice à la campagne. II les regardait, selon Garinet, « comme des dépôts confiés à sa charité ».
V -LE CANONICAT ET LES DERNIERES ANNEES
Un chanoine aisé et généreux
Lorsque le 16 juin 1834, I'abbé Brisson fut nommé chanoine titulaire de la Cathédrale de Châlons, il quitta l'Épine, mais il accepta encore à soixante treize ans de faire partie de la commission de l'Enseignement primaire. Celle-ci délivrait notamment les Brevets de Capacité aux aspirants-maîtres, et Brisson fut assidu dans les jurys d'examen. Mais cette commission entra en conflit avec la commission de surveillance de l'École Normale, dont le curé de la Cathédrale Hurault , Garinet, et quatre autres notables étaient membres. Comme il s'était installé à Châlons, Brisson redevint membre titulaire de la Société Académique. II fut aussi élu correspondant de la Société d'Agriculture, Sciences et Belles Lettres de Troyes. Le 31 mai 1837 après avoir vendu beaucoup de ses biens fonciers, il acheta une maison au n°6 de la rue du Cloître- aujourd'hui Juliette Récamier, à l'emplacement de l'immeuble de la Poste - où traditionnellement habitaient des chanoines (60). Il y vécut les derniers mois de son existence assisté de sa gouvernante Augustine, Françoise Laurent.
Sa famille avait fondu avec le temps. II ne lui restait que sa soeur Catherine, le fils de celle-ci Pierre Hubert, cultivateur à Soudron, et des petits-neveux ou arrière-petits-neveux, enfants ou petits enfants de Rose Hubert ou de Julie Hubert, les soeurs de Pierre, elles-mêmes décédées. Pierre Brisson ne se désintéressait pas de sa famille. II faisait confectionner des vêtements à son neveu Pierre Hubert par un tailleur de Châlons. II acceptait d'être caution pour son petit neveu Bonaventure Hubert, cultivateur à Soudron, quand celui-ci empruntait 7000 F à I'abbé Lallement, curé d'Écury-sur-Coole. Et il payait les frais d'apprentissage du fils de ce dernier, Adolphe, qui avait été placé chez le maréchal-ferrant de la Cheppe. II n'oubliait même pas une filleule : on le voit charger son ami le pharmacien châlonnais Desmarets de remettre un louis d'or à Séraphine Gatti, à l'égard de qui il avait contracté cette parenté spirituelle, et qui était placée en pension à Paris.
Généreux, il l'était encore avec la commune de Soudron. En 1823 il avait fait construire à ses frais une maison d'école. Sans doute par ce geste voulait-il honorer la mémoire de son père, qui avait passé l'essentiel de sa vie à enseigner les enfants de Soudron. En 1825 il vendit à la commune pour 4000 F le presbytère, qu'il avait peut-être acheté au début de la Révolution. La cession avait été consentie avec de larges facilités de paiement, puisqu'au décès de l'abbé en 1838, la commune lui devait encore 300 F. Mais ce presbytère, que I'abbé Gallois qui l'occupait jugeait « magnifique », avait sans doute été loué à la commune dès le Concordat de 1801. Et les biens de I'abbé Brisson étaient comme voués à l'utilité publique et à l'enseignement. En 1842 la commune de Soudron achetait aux héritiers de celui-ci une maison qui servait d'école de filles. Bien que la salle de classe fût exiguë – 4,50 m2 ! mais sans doute faut-il comprendre ( 4.50 m )x 2 soit 10,25 m2- elle fut utilisée jusqu'à la construction de bâtiments scolaires nécessitée par l'application de la loi Jules Ferry en 1881 (61 ). II est vrai que le chanoine Brisson était aisé. En 1836, peut-être parce qu'il ne pouvait plus s'en occuper directement, il avait vendu l'essentiel de ses terres de Saint-Martin-sur-le-Pré, n'y conservant que quelques oseraies. En contrepartie il avait acheté sa maison de la rue du Cloître et il avait placé une somme importante à la Banque Le Conte à Châlons (62) et dans des prêts à divers particuliers, un cultivateur de Saint-Martin, un pharmacien de Châlons et le directeur de I'Ecole Normale. A une époque où la Banque apparaît tout juste en Champagne -et ou les banquiers locaux ont des moyens très limités-, les investissements nécessités par une installation ou un agrandissement d'entreprise réclamaient des prêts de particulier à particulier. Les notaires qui connaissaient les disponibilités et les besoins de chacun servaient d'intermédiaires. Mais Pierre Brisson qui a aidé sa famille, a soutenu aussi des gens dans le besoin, un curé qui s'installait à Huiron, un vannier de Verzy ou un vigneron de Trépail, et ses héritiers, certainement sur ses recommandations ont renoncé à leurs créances.
Buffet, armoires et bibliothèque bien garnis
Pierre Brisson vivait ses dernières années au milieu d'un mobilier de qualité, qui sera estimé après son décès à 7309 F, somme évidemment inférieure à la valeur réelle. On y remarquait buffet et armoires de chêne, tables et commodes en bois des Iles, consoles anciennes, glaces et tableaux. Parmi ces derniers figuraient deux portraits, trois tableaux peints -une Sainte Famille, un David portant la tête de Goliath, un « trophée de raisins »-, plusieurs gravures encadrées, dont une représentation de la famille royale, etc... Plusieurs de ces tableaux se trouvent aujourd'hui dans les réserves du Musée de Châlons. Rien ne manquait à la batterie de cuisine, ou l'on recensa poissonnière, daubière et rôtissoire. La vaisselle de table n'était pas moins abondantes -cent assiettes de porcelaine de Saxe- ; la verrerie était aussi de qualité. On y trouva 18 flûtes à Champagne et un très beau cabaret de cristal. L'argenterie correspondait au reste, puisque les seuls couverts en argent massif furent estimés 472 F . La cave était bien garnie. A côté de la pièce de vin ordinaire, il y avait plus de 250 bouteilles de vins fins -surtout du Tavel, mais aussi des vins de Bourgogne et des vins de Cumières et de Vertus, onze bouteilles contenaient du « Champagne mousseux»-.
La garde-robe n'était pas moins pourvue. Le chanoine avait chez lui trois soutanes, quinze rochets de batiste ou de toile, un camail et un bonnet carré, mais aussi des ornements sacerdotaux, deux chasubles avec étoles et manipules. Mais le « costume long » de plus en plus recommandé au clergé ne sera vraiment imposé que sous Pie IX. Pierre Brisson avait encore deux redingotes, habit, pantalon et gilet. Les armoires étaient évidemment pleines de linge de maison, comme il se devait au XlXe siècle, quand les lessives n'étaient pas hebdomadaires.
La bibliothèque comptait 235 volumes dont l'inventaire fut malheureusement incomplet. II nous faut renoncer à savoir les titres des 35 volumes brochés et des 20 volumes dépareillés, que le notaire n'a pas détaillés et a estimés globalement à 3,70 F ! Le reste correspond surtout à deux orientations : I'Histoire, et particulièrement I'Histoire ecclésiastique, et l'éloquence, spécialement la rhétorique sacrée. A la première rubrique se rapportent I'Histoire des Conciles (édition de Cologne), l'Histoire ecclésiastique de Claude Fleury (1691), I'Histoire ancienne de Charles Rollin (1 730-1 738), I'Histoire Romaine de Laurent Echard (ouvrage anglais paru en 1699, traduit en français et publié en 16 volumes de 1728 à 1742, et en 12 volumes en 1802), l'Abrégé de I'Histoire de France du P. Daniel (9 volumes, 1724). Les Tables chronologiques de l'Histoire universelle de Nicolas Lenglet-Dufresnoy (1729), l'Art de vérifier les dates (énorme travail des Bénédictins de Saint-Maur dont il y eut plusieurs éditions au XVllle siècle et dont P. Brisson ne possédait qu'un abrégé en un volume in 4°).
Dans la seconde partie il faut placer les sermons de Bourdaloue, Massillon et « autres » (25 volumes), les Prônes de Jacques Denis Cochin (1786-1808), les Traductions des Orateurs grecs de l'abbé Alexandre Auger (décédé en 1792). l'Histoire de Fénelon de Mgr de Beausset (3 volumes, 1808), les Sermons de Saurin (12 volumes). A ces ouvrages s'ajoutaient neuf volumes de Droit et de Théologie, sans davantage de précisions, un Cours de Morale et de Religion, le Dictionnaire de la langue Française de Boiste (1800) et le Dictionnaire Géographique de Vosgien (pseudonyme de Ladvocat (1747). Des grands titres de la littérature française en vogue, figuraient seulement deux oeuvres de Chateaubriand, le Génie du Christianisme (1802) et les Martyrs (1 809).
Cette bibliothèque, austère, parait en tout cas fort ancienne. La plupart des ouvrages datent du XVllle siècle et on dirait que Brisson n'a plus rien acquis à partir de 1810. Certes les travaux théologiques ou apologétiques français du début du XlXe siècle ont été généralement fort médiocres, mais l'Essai sur I'indifférence en matière de religion de I'abbé de La Mennais avait eu du retentissement en 1817. Peut-être y avait-il des ouvrages plus récents dans les volumes brochés que le notaire a négligés ? On ne peut guère faire de réflexions au sujet de la présence parmi les livres de l'Histoire ecclésiastique de Claude Fleury, renommée au temps de Louis XIV, mais jugée fort gallicane par la suite et mise à l'Index à Rome, et même des Sermons de Jacques Saurin, ministre protestant. L'ouvrage est d'ailleurs indiqué dans l'inventaire sous le libellé « Sermons de Saurine en 12 volumes in 8° ». Or Jean-Pierre Saurine (1733-1813) évêque constitutionnel des Landes, député girondin à la Convention et évêque concordataire de Strasbourg, n'a pas laissé d'oeuvres oratoires. Les Sermons en question sont bien de Jacques Saurin (1677-1730). Ce sont les sermons sur divers textes tirés de l'Écriture Sainte publiés en 12 volumes à Londres en 1762. Mais ces textes étaient estimés des catholiques, notamment de I'abbé Maury qui reconnaissait à Saurin « le mérite oratoire que donne la nature », et on les a réédités encore en 1854.
En fait cet ensemble d'ouvrages anciens a pu être récupéré par l'abbé Brisson au décès de confrères par exemple. Ses héritiers partageront sa bibliothèque selon le souhait qu'il avait exprimé entre ses amis ecclésiastiques et ce devait être une habitude : des paysans n'auraient su que faire d'ouvrages érudits. II est vain de vouloir chercher dans ces titres une orientation particulière à la pensée de Pierre Brisson. Mais on saisit ici comment des ouvrages anciens, parfois estimés suspects voire condamnables, se sont retrouvés tardivement dans des bibliothèques ecclésiastiques et ont pu avoir encore de l'influence.
A la fin de 1837 la santé du chanoine Brisson déclina. Mais son entourage pensait que sa forte constitution viendrait à bout de la maladie. Pourtant l'élite du corps médical fut appelée à son chevet. Le docteur Moignon, un camarade de Collège, qui était son médecin traitant, avait voulu l'avis des Docteurs Prin et Dagonet. Pierre Brisson arriva au seuil de la mort en pleine lucidité, « soutenu au moment suprême par ses convictions religieuses », dit Garinet, qui fut souvent auprès de lui dans ses derniers moments. La mort le prit le 10 février 1838. Le service funèbre célébré à la Cathédrale rassembla beaucoup de monde « de tous les états et de toutes les conditions ». Les enfants de l'Hospice de Saint-Maur, pour qui il avait eu une particulière attention, portaient les cierges.
L'abbé Brisson avait rédigé son testament en octobre 1835. Jules Garinet, conseiller de préfecture et Alexis Desmarets, pharmacien devaient être ses exécuteurs testamentaires. La succession fut réglée par le notaire Arnould, fils de l'adjoint au maire en 1815 qui s'était alors porté garant des qualités du principal du Collège et condisciple de Jules Garinet dans ce même établissement. Le montant de la succession fut évalué à 68740 F, somme considérable pour l'époque. 30000 F furent partagés entre les légataires universels, neveux, petits-neveux, arrière-petits-neveux Hubert, qui descendaient de Catherine Brisson. Mais 38000 F avaient été attribués à des légataires particuliers. Parmi eux, certains petits neveux qu'il avait voulu avantager, des cousins, sa gouvernante -qui reçut 5000 F-, des amis prêtres, les abbés Renard, curé de Servon -son cousin au 5ème degré-, Lallement, curé d'Ecury, Champion, curé de Pogny, Gallois, curé de Bussy-Lettrée, Martin, curé de Corbeil, et le curé de Soudron- qui eurent chacun 100 F et le cinquième de la bibliothèque. Ses amis reçurent des souvenirs : le pharmacien Desmarets eut une pendule, sa femme une cafetière en argent, leur fille un couvert du même métal, Garinet -dont le légataire connaissait les goûts et la fortune- eut des médailles estimées 10 F mais recherchées des collectionneurs.
Pierre Brisson avait eu une existence bien remplie. Le fils du maître d'école de Soudron avait pris auprès de son père la vocation de I'Enseignement, et auprès du curé, I'abbé Rivier, celle du Sacerdoce. La voie était si bien tracée qu'il enseignait avant d'avoir reçu la prêtrise. Mais cette trajectoire si prévisible avait été bousculée par la Révolution. Fidèle à son engagement et sans goût pour les débats politiques, I'abbé Brisson partit pour l'exil. Mais après dix ans d'instabilité gouvernementale et de bouleversements sociaux, d'affrontement d'idées, justes ou utopiques, généreuses ou sordides, géniales ou absurdes dont les Français, descendants des Gaulois et toujours portés comme eux à la logomachie, cultivent encore les séquelles, il fallut bien finir la Révolution et reconstruire la société. Le collège de Châlons rouvrit ses portes avec les mêmes professeurs qu'en 1789. L'abbé Brisson en fut naturellement le principal. II remit sur le bon chemin un établissement qui fit honneur à la ville, même si vers 1820 les politiques conjointes de l'État et de I'église pouvaient lui causer quelques souci.
Mais I'abbé Brisson malgré sa culture, son goût pour l'Histoire et I'Eloquence, gardait les pieds sur terre. Disons même : dans la terre de Champagne. II avait acquis des biens dont il contrôlait l'exploitation et participait activement à la Révolution agricole qui se développait en Champagne à partir de Châlons. II célébra les Bourbons en 1814 ou en 1815, comme on le lui demandait, parce qu'ils allaient liquider l'aventure napoléonienne et renvoyer le peuple des campagnes à ses charrues, mais il n'en délira pas pour autant avec les Ultras.
La cure de I'Epine le remit au milieu des paysans dont il se sentait intimement solidaire. II comprenait profondément combien l'enseignement élémentaire leur était nécessaire. Nous savons bien aujourd'hui que le développement du Tiers-Monde passe d'abord par l'alphabétisation. Aussi contrôla-t-il avec soin les Ecoles du canton que l'ordonnance de 1824 lui avait confiées. Chanoine titulaire à Châlons dans ses dernières années, il continuait, en participant à la Commission de l'Enseignement primaire, à donner beaucoup de son temps à ce qu'il pensait être une condition nécessaire au progrès du monde rural.
Il manque à cette biographie beaucoup de détails, comme l'origine de sa fortune, ou même l'essentiel, à savoir la dimension sacerdotale de Pierre Brisson. Deux lignes de Garinet ne suffisent pas à caractériser ses sermons ; on ne sait rien de son influence religieuse et morale sur les élèves du Collège ; on ignore presque tout de son activité pastorale à l'Épine. Et doit-on conclure de l'examen incomplet de sa bibliothèque que Pierre Brisson, bon professeur, prêtre irréprochable, orateur féru de modèles, chanoine plus soucieux de confort que d'ascèse, a été davantage au courant des nouvelles techniques agricoles que des courants nouveaux de la théologie qui commençaient à secouer I'église de 1830 ?
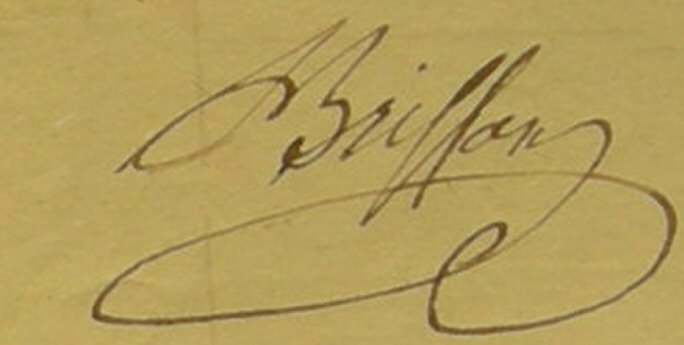 |
|---|
Georges Clause
"La vie de Pierre BRISSON, pédagogue, agronome et curé de l'Epine de 1822 à 1834",(33 pages in 8°) in Annales de Notre-Dame de l'Epine , n° 105 à 109, Châlons-sur-Marne, 1981-1982.
http://www.membres.lycos.fr/gclause/