(2) Un bibliophile chalonnais au XlXe siècle. Châlons, 1878 .(3) Abbé P. Gillet. Le drame der prétres-jureurs, Jacques-Martin Dupuis (1767-1838). Mém. Soc. Agr. Com. Sc. Et Arts de la Marne, 1977.4) Ach. dep. Marne , Registre paroissial de Soudron XVlle – Xvlle S.5) G. Laurent, Cahiers de Doléances du Bailliage de Châlons-sur-marne, 1906, p. 673.6) Arch. dép. Marne, C 430.7) E. Badinier, Amour en plus. 19808) G. Laurent, op. cit. p. 674.9) Le chirurgien Jean-Claude Desallangre, considéré comme un praticien renommé au début du XlXe riècle. aida Auguste-Hubert Titon à poursuivre ses études. Celui-ci devint un médecin estimé dont le nom d'une rue conserve le souvenir à Chalons. II devait épouser Aurélie Desallangre, petite fille du chirurgien.10) Arch. dep. Mame G 107 f°85.11) Abbé Gallois, Statistique du Canton d'Ecury-sur-Coole, Annuaire du département de la Marne 1823.12) Dictionnaire des Eglises de France (Laffont édit.) V B p. 112.13) Arch. dép. Marne 4 T 5514) Arch. dép. Marne L 52.15) Arch. dép. Marne L 61.
LA VIE DE PIERRE BRISSON (1761-1838)
PEDAGOGUE, AGRONOME, CURE DE L’EPINE DE 1822 à 1834
par Georges CLAUSE, Université de Reims
Le patronage de Jules Garinet
A qui veut parcourir I'existence du troisième curé de I'Epine après la Révolution, la tâche est apparemment facilitée par la biographie que lui a consacré Jules Garinet, peu après sa mort, en 1838 (1). En effet ce texte est un éloge qui fut lu dans une séance de la Société d'Agriculture, Commerce, Sciences et Arts de la Marne, comme il était de coutume après le décès d'un membre titulaire. Pierre Brisson était bien connu à Chalons : il avait été professeur au Collège avant la Révolution, il avait rétabli le Collège sous I'Empire, quand la ville eut été dépossédée de I'Ecole Centrale. On le savait possesseur de biens fonciers et féru; d'agronomie, alors même que I'agriculture était la principale source des revenus de la bourgeoisie chalonnaise. II n'y avait rien d'étonnant à ce que ce soit Jules Garinet qui se soit chargé de cet éloge. Ce dernier avait dû fréquenter le Collège de 1807 à 1816, alors que Brisson en était le principal. Sans doute n'en avait-il pas garde un mauvais souvenir - encore qu'il ne le dit pas -. Son éloge n'est finalement qu'un exercice de style, dans le goût de I'époque : on n'y trouve guère de remarques précises ou de notations personnelles, que I'historien d'aujourd'hui, qui voudrait pénétrer la psychologie de I'abbé Brisson, aurait aime rencontrer. Or Garinet était pourtant I'ami intime du vieux prêtre, dont il fut I'un des exécuteurs testamentaires. Dans ses derniers jours, I'abbé Brisson ayant à remettre une somme importante à sa gouvernante et ne pouvant plus le consigner par écrit, prit Garinet comme témoin. C'est assez dire que ce dernier en savait beaucoup plus sur son ancien maître qu'il ne l’a écrit. Peut-être est-ce par pudeur qu'il est resté ainsi la surface des choses ? Un problème cependant se pose d'emblée au chercheur qui a entrevu I'amitié de Brisson et de Garinet. Y avait-il en 1838 entre I'un et I'autre des affinités spirituelles ?
Jules Garinet (1797-1877), fils d'un maire de Chalons qui avait su en 1814 épargner à la ville le bombardement et le pillage et qui avait tenté de la faire entrer dans I’âge industriel pendant la Restauration, disposait d'une fortune suffisante pour le dispenser de chercher des moyens d'existence (2). Certes il avait fréquenté I'Ecole de Droit de Paris et s'était même inscrit au barreau de la capitale en 1818, mais revenu Chalons il s'était contenté de sinécures honorables, mais à peu prés gratuites, comme la charge de conseiller de Préfecture ou la présidence de la commission de surveillance de I'école Normale qu'il assuma après 1833. Il conservait encore les moyens de développer ses collections de tableaux, d'objets rares et de livres et le temps de se livrer à des recherches érudites.
Or au temps de la Monarchie de Juillet, I'orientation de son esprit, qui, découlait peut-être de son passage dans le monde estudiantin parisien à I'époque de I'alliance du Trône et de I'Autel, le rendait très critique à l’égard de beaucoup d attitudes catholiques et faisait de lui un gallican frondeur, très réservé à I'égard de la Papauté romaine. Dès 1818 il avait publié une plaquette de 80 pages intitulée « De la puissance temporelle des Papes et du Concordat de 1817 », très sévère à l'égard de ce Concordat, qui visait à rendre à I'Eglise de France une fortune foncière. Le gouvernement n'osa finalement pas proposer cette convention à la ratification des Chambres. II se contenta d'augmenter par ordonnance le nombre des diocèses : Châlons dépossédé de son siège épiscopal en 1801 retrouvera un évêque en 1824. Mais de la contestation de la politique réactionnaire des ultras, Garinet était passé à la critique de la Papauté elle-même. II se mit à écrire une « Histoire des Jésuites » qu'il n'osa jamais publier. II s'était plongé dans les sciences occultes et faisait paraître en 1818 une «Histoire de la Magie en France », qui fut mise à l'index, car I'Eglise n'aimait pas qu'on pénétrât dans le domaine de Satan. Garinet subissait sans doute l'influence de Jacques Collin, dit Collin de Plancy (1794-1881), homme de lettres et éditeur, qu'il avait dû rencontrer dans les milieux libéraux parisiens et dont l'évolution spirituelle ultérieure sera d'ailleurs curieusement semblable à la sienne.
Une «Histoire de la prostitution » que Jules Garinet laissa dans ses papiers, doit correspondre au même penchant de pénétrer dans les domaines réservés ou protégés par des « tabous ».
Dans les années 1830, Garinet est bien un bourgeois de l'époque Louis-Philippe, positiviste et déjà scientiste, cherchant à bon escient par des almanachs de qualité à détruire chez les paysans les usages et les préjugé ridicules, mais méfiant à l'égard de beaucoup de membres du clergé qu'il soupçonne d'obscurantisme. En 1839 il a rédigé une autre biographie, celle de Jacques Martin Dupuis, ancien prêtre constitutionnel devenu professeur à I'école des Arts et Métiers (3). Dupuis demeuré disciple de Grégoire, l’ancien chef de I'église constitutionnelle, dont il imita l'attitude au moment du Concordat, était peut-être, par les cas de conscience qu'il s'était posé et la façon dont ils les avait résolus, plus proche spirituellement de Garinet que Pierre Brisson. Car ce dernier est demeuré tout au long de sa vie attaché à I'Eglise Romaine. L'amitié, qu'il portait à Jules Garinet et que celui-ci lui rendait, ne doit donc nullement lui porter ombrage.
La biographie de I'abbé Brisson avait été d'ailleurs pour Garinet l'occasion de distribuer quelques coups de pattes. II y vantait la formation des prêtres à Châlons sous l'Ancien Régime pour dénigrer celle de son temps ; il faisait grief à I'abbé de n'avoir pas assez affiché son Gallicanisme, et au demeurant il n'avait guère parlé de son rôle de prêtre ; La vie spirituelle de celui-ci n'est évoquée nulle part. Garinet n'a décrit que le côté « citoyen » de son personnage. Cent quarante ans après la mort de I'abbé Brisson, il est sans doute bien illusoire de vouloir donner à son portrait la dimension omise par son biographe de 1838.
Disons cependant pour être juste avec Garinet qu'en vieillissant l'homme a beaucoup changé. Après 1870, le gallicanisme avant été étouffé au Concile du Vatican, il s’affichait comme un chrétien convaincu et fervent, édifiant ses amis à l'approche de la mort. Personne ne trouva à redire quand Mme Garinet offrit à la Cathédrale le vitrail de la Résurrection en souvenir de son époux.
I - SOUDRON
La famille du maître d'école
La preuve qu'il faut utiliser avec prudence la biographie écrite par Garinet, c’est que celui-ci affirme que Pierre Brisson est né à Soudron le 14 février 1758, bien que I'abbé ait cru toute sa vie qu'il avait vu le jour en 1761 ! Garinet explique que les registres paroissiaux de Soudron qu'on avait cru perdus venaient d'être retrouvés. Etrange ! Etait-il possible qu'au XVllle siècle, après deux cents ans de tenue obligatoire et régulière des registres paroissiaux, un habitant de la Champagne châlonnaise, où la majorité des hommes savaient lire et écrire, lettré de surcroît, ait eu sur sa naissance des idées aussi fausses ? Que les autorités diocésaines aient été induites en erreur au point de demander pour lui une dispense d'âge à Rome pour lui conférer la prêtrise ? En fait Garinet n'a pas su consulter le registre paroissial de Soudron, à moins qu'il ne se soit contenté que d'un renseignement de seconde main.
Car il est bien né au foyer de Pierre Brisson, maître d'école à Soudron et de sa femme Marie-Jeanne Desallangre, un enfant baptisé sous le nom de Pierre le 14 février 1758 (4). Mais celui-ci est décédé dix jours plus tard le 24 février. Et c'est presque trois ans jour pour jour, le 23 février 1761, qu'est né le Pierre Brisson dont nous allons essayer de raconter la vie. Dans sa Biographie châlonnaise parue en 1870, A. Lhote a eu le tort de retenir la date de Garinet Soudron.
Eglise St Pierre St Paul
Pierre Brisson (sosa 70), le maître d'école, tenait à ce que son prénom soit celui de son fils premier-né, puisqu'il le donna au second après le décès du premier. Cet usage était d'ailleurs fort répandu. Saint Pierre était l’un des deux patrons du village. Pierre Brisson était originaire de Fontaine-sur-Coole, comme le précise son premier acte de mariage, et non de Lenharrée, comme l'écrivait G. Laurent dans l'introduction du Cahier de Doléances de Soudron (5). Mais il y a beaucoup de Brisson à Soudron et dans les villages environnants. L'instituteur qui nous occupe s'était marié le 2 mai 1752 avec Anne Chaillaud de Soudron. Une fille, Marie-Josèphe, naquit en 1753, puis une seconde, Catherine en 1755, mais l'épouse mourut en juin 1756. Elle n'avait que trente ans. En ces temps -déjà si lointains des nôtres pour l'art de vivre- où la médecine n'était que balbutiante, les hommes se mariaient souvent plusieurs fois, car leurs femmes étaient dangereusement soumises aux aléas des accouchements. Onze mois après le décès de sa première femme, Pierre Brisson se remaria avec Marie-Jeanne Desallangre, fille mineure de Pierre Desallangre et de Marie-Jeanne Collot décédée. Deux ans plus tôt, Elisabeth Brisson, sa soeur, avait épousé Pierre Desallangre : le maître d'école avait convolé en secondes noces avec la soeur de son beau-frère. Et la première belle-famille n'y voyait pas d'inconvénient, puisque Louis Chaillaut, frère de I'épouse décédée, était le témoin du marié.
On sait déjà que le premier enfant né de cette union mourut presque aussitôt en 1758. Un an après, en 1759, naissait une fille, Marie-Rose, puis en 1761 celui qui sera I'abbé Brisson. Son parrain fut Joseph Desallangre, vraisemblablement oncle de sa mère, et sa marraine Marie-Anne Rivier, une parente du curé de la paroisse. En 1763, naissance d'une fille, Rose-Victoire, et en janvier 1766 celle d'un fils, Charles. Mais la mort frappe : Charles n'aura vécu que dix jours et la même année Marie-Rose est enlevée à l'âge de sept ans ; en mai 1767 c'est au tour de Rose-Victoire de disparaître. Au foyer de Pierre Brisson qui avait connu six naissances, il ne restera que Marie-Josèphe et Catherine, nées du premier mariage, et Pierre, né du second. Le foyer de Pierre Desallangre et d'Elisabeth Brisson, oncle et tante de l'abbé connaissait les mêmes déchirements à l'été 1766 : le 14 juillet mourait leur fils aîné Louis qui n'avait que quatre ans, quatre jours plus tard décédait leur second fils Charles. Trois semaines plus tard leur naissait un autre enfant que I'on prénomma à nouveau Charles, mais celui-ci mourait six jours plus tard. L'été était une saison dangereuse à cause des troubles intestinaux qui emportaient les nourrissons et les jeunes enfants. Nous saisissons ici sur le vif le phénomène de l'effrayante mortalité qui sévissait dans les villages il y a deux cents ans. Quelles causes faut-il incriminer ? Les soins peu éclairés, les carences alimentaires, les épidémies ? Un peu de tout cela sans doute. En tout cas il faut mettre beaucoup d'enfants au monde, si I'on veut que la famille et le village subsistent. La fréquence de la mort ne pouvait qu'inspirer aux hommes un certain fatalisme. Dieu reprenait la vie comme il la donnait. Que sa volonté soit faite !... Et le 14 septembre 1767 naissait un Pierre Louis Desallangre qui, lui vivra.
Une paroisse de la Champagne pouilleuse
Soudron était en 1773 un village de 424 habitants, allongé sur un quart de lieue au long de la Soude (6). La longueur particulière de la localité tenait au fait que chaque maison était nettement détachée de sa voisine. Elle était entourée d'un jardin ou d'un clos et on reconnaissait ici comme dans d'autres villages champenois tel Courtisols (la vieille structure médiévale des « manses ») maison et exploitation familiale adjacente-, disposés au long du cours d'eau dispensateur de vie, attribués par le seigneur à ses manants qui, en retour, lui rendaient des services et cultivaient sa réserve. La population de 1773 comprenait 165 hommes et 183 femmes âgés de plus de sept ans, 31 garçons et filles au-dessous de cet âge. La moyenne annuelle des naissances qui entre 1755 et 1766 s'établit à 13,18 représente un taux de 34.4 pour 1000. Taux énorme en comparaison de celui de la France d'aujourd'hui devenue hyper-malthusienne, mais presque compensé par celui des décès, qui était de 33 pour 1000, soit 11 par an en moyenne. A noter que 9 des décès enregistrés après 1761 ne concernaient pas vraiment la population de Soudron : il s'agissait d'enfants de Châlons placés en nourrice dans le village. L'extension du placement en nourrice qui s'étend à cette époque aux classes moyennes châlonnaises, donne aujourd'hui à réfléchir aux historiens qui s'interrogent sur la vraie sensibilité du XVllle siècle et remettent en question l'amour maternel (7). Si I'on compte à part ces décès d'enfants châlonnais. le taux de mortalité se ramène à 31 pour 1.000 dans la population soudronnaise. Le tiers des décès concerne des enfants de moins de quatre ans ; les décédés de plus de soixante ans n'en sont que le quart.
Autre remarque découlant d'une consultation rapide du registre paroissial. Entre 1755 et 1766, il y a eu à Soudron 33 mariages. Dans 22 de ces unions, soit 66 %, les deux conjoints étaient des habitants du village même. Dans les onze cas restant, le marié provenait d'une autre paroisse, mais les plus éloignées étaient toutes proches de Châlons, d'Avize ou de Vertus ; en fait, Il est fort rare que le marié soit né à plus de deux lieues de Soudron. Comme l'endogamie paroissiale l'emportait largement, il fallait souvent des dispenses épiscopales en raison de parenté au troisième ou quatrième degré. Le registre est pratiquement rempli avec les naissances, les mariages et les décès d'une douzaine de familles, les Brisson, les Desallangre, les Rivier, les Chailliaut, les Celliez, les Hubert, les Lallement, les Titon, etc…
L'activité des habitants de Soudron était totalement agricole. Le cheptel en 1773 comprenait 75 chevaux, 175 bêtes à cornes, 450 « bêtes à laine ». Mais il y avait tant de terres incultes et les jachères étaient si longues que pour se dire « laboureur » et occuper une charrue toute l'année, on estimait qu'il fallait cultiver un domaine de 125 arpents de Paris, soit 42,73 hectares. Le terroir comprenait en 1773, 2500 arpents de terres « propres à faire farine », soit 855 hectares, mais seulement 35 arpents ou 12 hectares de prés, ce qui limitait l'élevage et la production de fumier. Aussi un tiers au moins des terres cultivables demeurait en jachères improductives, et il y avait 4500 arpents de terres incultes, soit 1538 hectares ! Les récoltes paraissent d'ordinaire bien médiocres, même si I'on admet que les autorités les ont faiblement évaluées par crainte d'une augmentation des impôts : 425 boisseaux de froment, soit 55 hectolitres, 4560 boisseaux de seigle soit 592 hectolitres, 62 d'orge, 1193 hectolitres d'avoine, 88 hectolitres de sarrazin. Quantités minimes si on les rapporte au nombre des cultivateurs : 15 hectolitres de céréales panifiables par laboureur ! On ne pouvait guère vendre que de l'avoine. Des acheteurs parisiens venaient la chercher sur le marché de Châlons. Au long de la Soude, il y avait trois moulins, mais ils devaient aussi moudre pour les villages des environs.
La seigneurie de Soudron appartenait, pour l'essentiel, à Louis, Charles, Victor du Cauzé de Nazelles (8). Marquis depuis 1756, nommé gouverneur de Châlons en 1777. Il avait acquis cette seigneurie par son mariage avec l'héritière de la famille de I'Epine. Le seigneur n'était pas sur place : il devait se faire représenter par des « officiers » tirés du milieu rural. En 1760 le bailli est Pierre Titon ; il meurt en 1763. Son fils, nommé Pierre, lui aussi, porte le titre de « lieutenant » en 1773. Il épousera cette année-là Marie Brisson, une cousine de I'abbé. Le « procureur fiscal » est alors Claude Lallement qui a succédé dans cette charge à son père Jean. II est vraisemblable que le greffier du bailli est alors le maître d'école Pierre Brisson. On ne parle jamais du syndic, mandataire des habitants, qui en 1789 était le chirurgien Jean-Claude Desallangre (9).
Moeurs et Religion
Soudron était un village tranquille ... encore que le 20 août 1760 soit consignée sur le registre de la paroisse l'inhumation d'un jeune homme du village qui avait succombé à des blessures reçues dans une rixe. Mais le curé déclarait à l'évêque en 1747 qu'il ne connaissait aucun procès en cours, ni aucune inimitié ouverte (10) et en 1822 I'abbé Gallois écrivait à propos de son village natal : « Ce qui rend l'habitant digne d'éloges, c'est la douceur de son caractère. la politesse de ses procédés et la pureté de ses moeurs. Une jeune personne qui manquerait à l'honneur de son sexe serait un phénomène dans la paroisse (11)». Cette dernière remarque pourrait s'appliquer soixante ans plus tôt. Entre 1755 et 1789, il n'y a eu à Soudron qu'une seule naissance de père inconnu. Cette « pureté des mœurs » est-elle liée à la pratique religieuse ?
Au coeur du village se dressait une belle église médiévale, dédiée aux saints Pierre et Paul, dont la construction remontait aux Xlle et Xllle siècles (12). Les parties basses de la façade et de la nef avaient été bâties dans la première partie du Xlle siècle, comme en témoignent les chapiteaux romans. Le transept et l'abside, les parties hautes de la nef datent du début du Xllle siècle. Mais plus que les clés de voûte sculptées, ce qui frappait le visiteur, c'était le beau retable de la Passion en pierres polychromes, oeuvre de la Renaissance (13). Les patrons de I'église encadrent les scènes de la passion du Christ et de sa résurrection. Parmi les groupes on remarque un saint Michel terrassant le dragon et un Christ dans le prétoire. On imagine l'influence sur l'esprit des fidèles à l'âme simple et des enfants, de ces tableaux qui exprimaient la foi chrétienne, et dont le curé pouvait se servir dans ses homélies ou son enseignement. C'est là que Pierre Brisson a été baptisé et on l'y verra assurer le culte à la fin de la Révolution.
Mgr de Choiseul-Beaupré, évêque de Châlons, avait visité Soudron en 1747. II estima I'église en bon état, demanda pourtant quelques réparations à la toiture, la construction d'une sacristie, le pavage des bas-côtés et le changement de l'autel qu'il aurait voulu voir «à la Romaine ». En examinant les comptes de la fabrique, il recommanda aussi de ménager les cierges !
Le curé présent en 1747, se nommait Pierre Rivier et il était né à Villeseneux en 1711. Nommé curé de Soudron en 1738, où il avait succédé à Gabriel Lemoyne, il y mourra en septembre 1785. Il vivait en 1747 avec une nièce et un neveu dans un presbytère en bon état. Les revenus de la cure se montaient à 500 livres, ce qui était peu. Les dîmes étaient perçues à Soudron par le chapitre de la cathédrale de Châlons, à qui revenait la présentation du curé, et par les abbés de Toussaints et de la Charmoye. Les Soudronnais payaient-ils sans maugréer ces dîmes qui n'allaient pas à leur église ?
La famille du curé était liée par des mariages à la famille Brisson : en 1777 un Pierre Rivier de Villeseneux, veuf d'une Marie-Rose Brisson, se remaria avec une Marie-Tanche Desallangre.
Dans son rapport de 1747, I'évêque note, sur les dires du curé, que Soudron a 270 communiants et deux personnes seulement sont citées nommément pour n'avoir pas accompli leur devoir pascal. L'une des deux était un certain Claude Brisson, «lequel ne s'est point présenté au moins depuis douze ans suivant le rapport que j'entends faire ». Ce Claude Brisson n'est certainement pas le Maître d'école, qui à cette date portait le même nom, car on ne l'aurait pas maintenu dans sa charge. Cependant, ce dernier, âgé de cinquante ans, était dit « négligent pour l'instruction des enfants ». II est vrai que pour ce travail il n'était payé que 150 livres ! Et il n'y avait pas là de quoi entretenir le zèle pédagogique.
Le curé remplissait ses devoirs, mais il ne semblait pas en faire plus qu'il n'était besoin. Si le Saint Sacrement est exposé comme il convient à l'époque de la Contre-Réforme, la prière du soir à I'église est supprimée à « cause de la longueur du village. Le prône et le catéchisme se font exactement... si les peuples y assistent assez ! ». II est de fait qu'une forme plus concentrée du village eût facilité la fréquentation de I'église. Mais on peut penser que lorsque l'assistance est insuffisante, l'office est écourté et les enfants du catéchisme renvoyés. Et autour de I'église, il n'y a pas de confrérie ; il est vrai que les « œuvres » qui s'étaient largement développées au XVlle siècle connaissaient un recul général au XVllle et ne reprendront de l'essor qu'au milieu du XlXe siècle. Mais I'évêque, reprenant sans doute les idées rigoristes du curé, avait jugé l'ambiance du village en 1747 beaucoup plus sévèrement que l'abbé Gallois en 1822. A l'en croire, on aimait trop le vin à Soudron. L'ivrognerie sévissait et le cabaret, ouvert même pendant les offices des dimanches et fêtes, faisait dangereusement concurrence à I'église ! «Plusieurs profanaient... ces jours sacrés » par des danses publiques. Aussi Mgr de Choiseul-Beaupré adjurait-il les officiers de justice de faire cesser ces scandales en faisant « exécuter les ordonnances royaux» et en punissant les contrevenants « suivant toute la sévérité des loix ». II exhortait le curé à s'élever « avec tout le zèle dont il était capable contre ces désordres et à refuser l'absolution à ceux et à celles qui ne voudraient pas obéir» ...
Pourtant au sortir de I'époque napoléonienne, soixante-dix ans après la visite de Mgr de Choiseul-Beaupré.il y aura dans le diocèse cinq prêtres Originaires de Soudron, alors que le manque de pasteurs était manifeste dans toute l'Eglise de France. Quand on cherche à apprécier l'influence de la Religion sur le comportement d'une population il ne faut pas s'en tenir à un seul critère et se garder de donner trop d'importance aux buveurs qui s'agitent dans le cabaret à l'heure de la messe ou aux jeunes gens qui montrent leur allégresse en dansant le jour du Seigneur.
La Champagne est traditionnellement pauvre. Cependant l'abbé Gallois écrivait vers 1820 à propos de Soudron : «Ce n'est pas que les fortunes y soient brillantes, mais l'économie de tous les habitants y maintient une heureuse aisance au milieu du sol peut-être le plus ingrat de la Champagne. La paresse est un vice absolument inconnu et le jeune adolescent conduit déjà sa charrue dès le printemps de sa vie. Peut-être même y a-t-il un vice sous ce rapport parce qu'on y porte trop loin l'esprit d'intérêt...». On serait tenté de penser qu'en 1820 la première révolution agricole champenoise avait déjà porté des fruits et effectivement les surfaces emblavées avaient nettement augmenté depuis 1760. Et que s'il restait des signes d'avarice, celle-ci avait été amplement justifiée par des siècles de misère, où l'imprévoyant était réduit à l’indigence. Mais une appréciation de la fortune des Soudronnais d'après la fiscalité au début de la Révolution va laisser perplexe.

Soudron : Retable de la Passion milieu du XVle siècle
Un maître d’école, notable du village
Le père de l'instituteur Pierre Brisson (On nous pardonnera ce titre presque inusité pour cette fonction rurale en 1789) se nommait Jean Brisson et il avait épousé Didière Hubert de la paroisse de Fontaine-sur-Coole. On ne sait rien de sa condition, il est mort à Soudron le 25 juillet 1760. Le maître d'école, jugé pas trop zélé lors de la visite épiscopale de 1747, se nommait Claude Brisson. Pierre Brisson, quand il prit en charge I'école a donc succédé à un parent, mais pas à son père. Pour juger objectivement la qualité des instituteurs de Soudron à la fin du XVllle siècle, on peut remarquer qu'au bas des actes inscrits dans le Registre paroissial pratiquement tous les hommes requis de signer ont pu le faire et souvent sans peine. Mais entre 1755 et 1765 on ne rencontre que trois signatures féminines -celles de marraines à l'occasion de baptêmes- et seulement à partir de 1762. Une jeune mariée ne signe jamais la mention de son mariage, pas plus que les mères des époux. II semble même qu'on ne leur ait pas demandé, tant il est admis que les femmes sont illettrées ! La femme ou la fille de l'instituteur ne font pas exception à la règle, alors que la nièce du curé, Marie-Magdelaine Rivier, elle, sait écrire son nom. Faut-il incriminer la pédagogie du maître d'école ? II semble au contraire qu'on ait été satisfait des capacités de Pierre Brisson. II est plus vraisemblable que les filles fréquentaient peu I'école, alors qu'il était de règle que les garçons y allassent. Et si les filles n'allaient pas à l'école, c'est qu'il n'y avait pas dans le village d'école particulière pour elles, et que le clergé n'aimait pas les écoles mixtes. Peut-on aller jusqu'à imaginer que le curé déconseillait aux parents d'envoyer leurs fillettes à l'école et qu'il avait instruit sa propre nièce, cependant que I'instituteur, pour suivre les recommandations du curé, n'admettait pas sa propre fille dans sa classe ?
En 1747 le maître d'école recevait 150 livres de la paroisse. A cela s'ajoutaient sans doute des écolages, payés par les parents des élèves -en argent ou en nature- et le casuel du clerc paroissial. II n'y avait pas de quoi vivre dans l'aisance et on n'a pas de raison de penser que la condition du maître d'école ait changé entre 1747 et 1770. Or Pierre Brisson pourra envoyer son fils au collège de Châlons. Certes une aide particulière, une bourse ont pu lui être attribuées, mais le collège, pas plus que le séminaire, ne s'ouvrait pour les enfants totalement démunis. L'enseignement était gratuit mais pas la pension. Pierre Brisson était d'ailleurs bien loin de cette catégorie. En mars 1789, il était désigné avec le «lieutenant» Pierre Titon par l'Assemblée de la paroisse pour la représenter à l'Assemblée du Tiers du Bailliage. La loi électorale instituée par l'Assemblée Constituante va d'ailleurs révéler son aisance. En avril 1790 il était parmi les citoyens « éligibles», ceux qui payaient une contribution directe supérieure à un salaire de dix jours de travail (14). Ce salaire d'une journée avait été évalué à 1 livre, or, P. Brisson paie 44 livres 8 sols. C'est la septième cote de la paroisse. Les plus gros contribuables étaient Joseph Desallangre et le curé imposés respectivement à 67 et 66 livres. Pierre Hubert le jeune gendre de Brisson payait 31 livres 7 sols. II faut se méfier de l'idée toute faite de la pauvreté irrémédiable des habitants de la Champagne pouilleuse, même si l'on admet qu'ils sont surimposés. A Soudron 74 chefs de famille paient plus de 10 livres et 10 seulement, imposés entre 3 et 10 livres, sont dits «citoyens actifs de seconde classe ». D'ailleurs les maîtres d'école ne sont pas en général de « pauvres diables ». Lorsque l'assemblée primaire du canton de Cernon, auquel ressortit Soudron, se réunit le 10 mai 1790 sur la place du chef-lieu, c'est le recteur d'école de Sogny-aux-Moulins qui est désigné comme secrétaire provisoire ; en mai 1791 c'est le recteur d'école de Bussy-Lettrée qui est élu président (15). En 1790 et en 1791, un laboureur de Soudron, Jean Chailland, figure parmi les six élus de l'assemblée des électeurs du District. Mais Gustave Laurent qui place Pierre Brisson parmi les administrateurs du district de Châlons, paraît avoir fait une confusion. De toute façon il faut admettre que la famille Brisson possède des biens fonciers.
La vocation ecclésiastique
De l'enfance du futur clerc nous ne savons rien. En 1766 un Pierre Brisson parrain déclare ne savoir signer : il est possible que ce soit le fils de l'instituteur qui n'avait que cinq ans. En août 1775 c'est bien lui qui est le parrain de sa nièce Marie-Rose, née du mariage de sa demi-sœur Marie-Josèphe avec Jean-Charles Hubert. Quelques mois plus tard, le 15 janvier 1776, il était le témoin de son autre demi-soeur Catherine qui épousait Pierre Hubert et le 11 octobre de la même année il était le parrain de leur fils Alexandre. En juin 1777 il est témoin au mariage d'un Pierre Rivier de Villeseneux, veuf d'une Marie-Rose Brisson, et qui épousait en secondes noces une Marie-Tanche Desallangre. Tout donne à penser que l'abbé Rivier, le curé de Soudron, faisait vraiment partie de la famille de Pierre Brisson. Et cet ecclésiastique, sur lequel planaient les réticences voilées de l'évêque en 1747, et dont nous ne connaissons que l'écriture, a dû avoir pourtant une forte influence sur ses ouailles. On pourrait lui attribuer quatre vocations sacerdotales, celles des abbés Brisson, Gallois qui desservira un jour Soudron, Titon futur curé de Vitry-la-Ville, Lallement plus tard curé de Cernon. Sans doute le curé, complétant l'enseignement de I'instituteur, donnait-il aux enfants qui rêvaient du quelques notions de latin avant de les envoyer au collège.
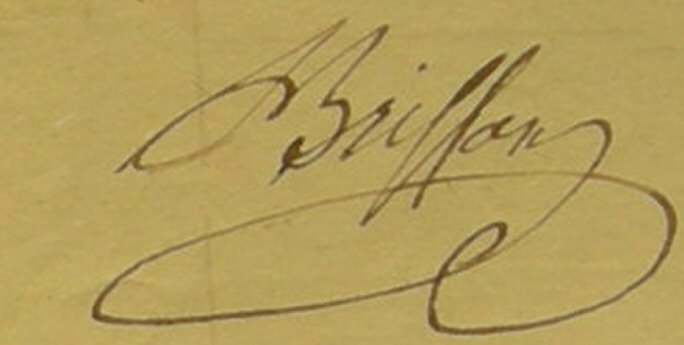 |
|---|
Georges Clause
"La vie de Pierre BRISSON, pédagogue, agronome et curé de l'Epine de 1822 à 1834",(33 pages in 8°) in Annales de Notre-Dame de l'Epine , n° 105 à 109, Châlons-sur-Marne, 1981-1982.
http://www.membres.lycos.fr/gclause/